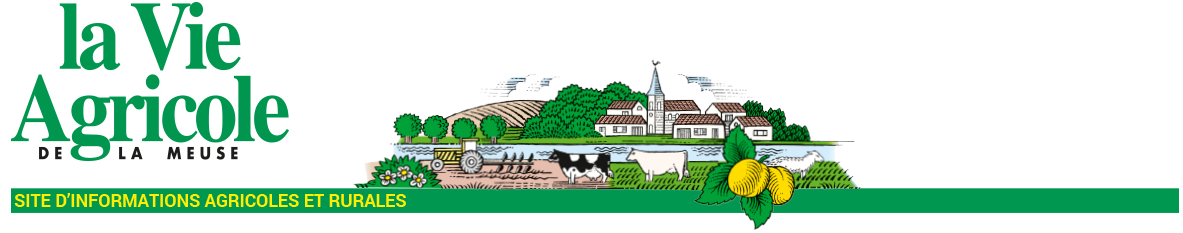Trois ans après son lancement dans le département, la démarche Pâtur’ajuste a réuni ses acteurs, lundi 6 octobre, au GAEC de la Creuë, à Maizey. Éleveurs, conseillers agricoles, représentants du Conseil départemental et partenaires techniques ont répondu présent pour faire le point sur les résultats et tracer des perspectives pour l’avenir.
Comment mieux valoriser les prairies dans les exploitations agricoles, tout en améliorant la rentabilité et en préservant les ressources ? C’est à cette question que tente de répondre le projet Pâtur’ajuste, un collectif réunissant éleveurs, chercheurs, conseillers agricoles et chargés de mission environnement.
Dans la Meuse, cette démarche s’est intégrée au Plan Herbe, co-piloté par une quinzaine de partenaires. Elle a pour objectif d’accompagner les agriculteurs vers des systèmes d’élevage plus durables, en valorisant les ressources locales et en préservant l’environnement.
Une journée d’échanges sur le terrain
La rencontre du lundi 6 octobre a permis de dresser un bilan de trois années de collaboration. Les participants ont été accueillis par Nicolas et Alexis Brouet, exploitants du GAEC de la Creuë à Maizey. La journée s’est déroulée en deux temps : une matinée consacrée aux élevages laitiers, suivi d’un atelier dédié aux élevages allaitants l’après-midi. Les membres du dispositif ont échangé autour de cas concrets, avec des comparaisons entre exploitations et des témoignages d’éleveurs engagés dans la démarche.
«L’objectif est de trouver les leviers qui fonctionnent localement, en tenant compte des ressources naturelles, du climat et des objectifs de chaque éleveur. Il faut adapter les pratiques à son terrain» a rappelé Philippe Mestelan, animateur de Pâtur’ajuste et conseiller au sein de Scopela.
Nicolas et Alexis Brouet, à la tête d’un troupeau de 40 vaches laitières Prim’Holstein et autant de vaches allaitantes de race Blonde d’Aquitaine, ont modifié leurs pratiques d’élevage en 2020 sur le troupeau laitier. Leur objectif : produire du lait au pâturage et à l’herbe, avec des résultats stables dans le temps. Ce changement a fait suite à plusieurs années de sécheresse, à un mauvais rendement du maïs et à une production laitière moyenne par rapport aux coûts d’alimentation.
Et le bilan est plutôt positif. Ils ont arrêté l’usage d’engrais chimiques, préférant l’utilisation du compost. «Il y a moins de tassement du sol, la végétation est plus forte, plus enracinée, plus diversifiée», ont-ils conclu après trois ans de suivi.
L’achat d’alimentation a chuté de 30.000 € à 6.000 €. L’allongement de la période de pâturage a aussi permis de gagner du temps, avec en moyenne «une coupe mangée directement sur pied». Quant aux problèmes de santé du troupeau laitier, ils ont diminué, passant de 25 mammites en 2021 à seulement 10 en 2024.
Une évolution du système allaitant
Depuis 2023, la gestion du troupeau allaitant a également évolué. Avec les périodes de sécheresse récurrentes, les éleveurs devaient utiliser les râteliers de foin dès le mois de juin. Ils avaient aussi récupéré des prairies très dégradées lors du remembrement, mais les tests de sursemis n’avaient pas été concluants.
«On a arrêté l’engrais, on a arrêté la herse», a souligné Alexis Brouet, qui désormais «se retient de faucher pour mettre les vaches au parc». Les vaches allaitantes ont pâturé une parcelle en bord de Meuse dès le début du printemps. «Les animaux sont rentrés au fur et à mesure des vêlages, groupés entre mi-août et mi-septembre pour la majorité du troupeau. C’est plus simple pour la gestion des parcs», a poursuivi l’éleveur.
Après quelques années post-resemis, la flore s’est diversifiée grâce à un bon recrutement d’espèces autochtones, capables de supporter à la fois les inondations et les fortes chaleurs. Les éleveurs ont désormais des stocks sur pied.
«Ici, la végétation a beaucoup changé en trois ans. Et ce renouvellement a été rendu possible grâce à la mise au parc», a-t-il reconnu. Ces nouvelles pratiques ont aussi permis l’observation de courlis dans la repousse printanière.
Des résultats économiques et humains
Sur le plan économique, la réduction de la fauche a permis de diminuer les charges de 4.340 €, partagées entre les coûts d’engrais chimiques et ceux des récoltes. Le temps de travail a lui aussi été allégé, avec un gain estimé à 50 heures par an, grâce à une gestion simplifiée des râteliers et à une diminution des récoltes.
«Dès qu’un agriculteur change de système, il y a un risque à évaluer. Il faut y aller parcelle par parcelle», a conseillé Philippe Mestelan qui suit le GAEC.
Et maintenant ?
Au-delà des chiffres, les participants ont souligné l’importance des échanges entre pairs et de la dynamique collective. Pâtur’ajuste a initié une réflexion plus large sur l’évolution du métier d’éleveur et les attentes de la société.
Tous se sont accordés sur la nécessité de poursuivre la démarche et de l’ouvrir à d’autres exploitations. «Il faudra peut-être travailler sur une formule plus libre, car même si les sujets sont partagés, les pratiques sont très différentes», a proposé l’animateur de Pâtur’ajuste. Il a rappelé qu’en trois ans, huit journées de travail collectif ont été organisées et trente fermes volontaires ont été accompagnées.
Le Conseil départemental, partenaire historique du projet, a salué le travail accompli et envisagé d’accompagner les prochaines étapes, notamment en renforçant les synergies avec d’autres dispositifs agricoles et environnementaux. Pierre-Olivier Lausecker, de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, a ouvert plus largement le débat : «comment rendre attractif le métier d’éleveur avec un système confortable et cohérent ?».
Les échanges entre éleveurs et partenaires confirment qu’en agriculture, l’avenir se construit aussi par les changements de pratique.