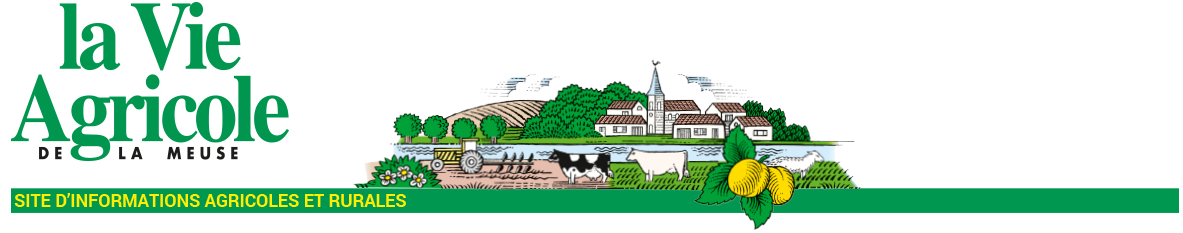L’Union laitière de la Meuse a organisé deux journées techniques sur l’optimisation de la ration fourragère des vaches laitières, les 15 et 16 juin. Trois ateliers ont pu être suivis par les nombreux agriculteurs venus sur place.
L’Earl Lemoine-Jusnot à Commercy a accueilli la première journée technique sur l’optimisation de la ration des vaches laitières avec le fourrage 2023, le jeudi 15 juin, avant une deuxième journée à Delut pour le nord meusien. Désireuse de communiquer de nouveaux résultats et connaissances, la coopérative a souhaité «partager et surtout dynamiser la production de lait en montrant toutes les optimisations possibles», a déclaré en préambule Olivier Catros, responsable des services développement et qualité de la coopérative.
Au programme, l’importance de l’azote, des sucres, et de l’amidon dans la ration des bovins laitiers. Les éleveurs, séparés en trois groupes d’une dizaine de personnes, ont pu profiter d’interventions de conseillers et échanger autour des éléments nécessaires pour composer une ration idéale pour les vaches laitières.
La conservation est déterminante
Un des ateliers portait sur l’azote, et sur les moyens de le valoriser au mieux dans la ration. Selon les résultats écolait, le lait produit par l’azote des fourrages varie du simple au triple selon les exploitations, et la valorisation optimale de cet azote conditionne une amélioration de la marge alimentaire de 40 €/1.000 l. Il est donc important de maximiser l’apport de protéines par les fourrages, moins coûteux, en considérant le stade de récolte de l’ensilage d’herbe, qui pourra être plutôt «laitier», «équilibré», ou «fibreux», avec plus de volume mais une valeur alimentaire moindre. La réalisation d’analyses (valeurs alimentaires et qualité de conservation) permet d’ajuster plus efficacement la ration.
La conservation de l’ensilage est aussi déterminante pour limiter les pertes. Un bon tassement du silo est primordial ; le premier facteur qui influence le tassement est l’épaisseur des couches, ainsi que le taux de matière sèche. Un silo trop sec ou trop humide entrainera une mauvaise fermentation. «Si le silo est bouillant, il met à mal tous les efforts fournis par l’agriculteur» a expliqué un intervenant, précisant «que si le fourrage chauffe plus de 18 jours, c’est la moitié des protéines qui partent en fumée». Si le silo chauffe trop longtemps, les pertes peuvent atteindre 3 % par jour, et jusqu’à 15 % en dix jours.
Le recours aux conservateurs peut s’avérer utile, mais doit être raisonné compte-tenu de leur coût. Des clés ont été données aux éleveurs pour identifier les situations à risque, notamment si le taux de matière sèche est inférieur à 30 %. Deux sortes de conservateur sont utilisables, acides ou biologiques ; les conservateurs acides sont plus coûteux et efficaces pour des fourrages humides et pauvres en sucres.
Sucres : l’intérêt de la betterave
Un autre atelier était consacré aux «sucres sous toutes leurs formes». Il a permis de rappeler l’importance du sucre, plus ou moins présent selon le stade de récolte de l’herbe : un ray grass fauché en avril compte 13 à 18 % de sucres, contre 10 % s’il est récolté début mai. La betterave peut apporter une valeur ajoutée intéressante, a expliqué Lionel Vivenot, conseiller élevage laitier à l’ULM, qui accompagne un groupe d’éleveurs expérimentant cette culture depuis plusieurs années. La betterave possède une valeur énergétique constante, dont l’incidence se ressent sur l’état de santé des vaches, avec notamment la diminution des mammites et un meilleur état corporel. Des rencontres vont avoir lieu cet automne avec une société qui travaille au Danemark, grand utilisateur de betteraves dans ses rations. Ce pays a une certaine expérience de la technique de conservation dite «silo sandwich», qui semble intéressante ; déjà testée en Meuse, elle consiste en un silo avec une couche de maïs ensilage sur laquelle vient s’ajouter une couche de betteraves hachées.
Un dernier atelier visait à informer notamment sur le taux d’amidon nécessaire dans la ration des vaches laitières, rappelant non seulement le besoin de glucose et donc d’amidon pour le transformer en lactose, constituant essentiel du lait, mais aussi l’importance de la digestibilité de l’amidon, dégradé à des vitesses différentes dans le rumen. Les points de repère étant de 20 % d’amidon et de 5 % de sucre pour la ration à l’auge, avec un rapport Amidon + Sucres / Cellulose de 1,15 afin d’éviter le risque acidogène.
En conclusion, avant le repas sur place, les intervenants ont rappelé la nécessité de penser d’abord à l’énergie pour équilibrer la ration, puis à l’azote, ainsi que l’apport de fibres pour la digestion et de sucres pour l’appétence. Sans oublier de réaliser des contrôles réguliers visuels et chiffrés, et d’avoir des points de repères, fruits de la discussion avec les conseillers du service développement de la coopérative.