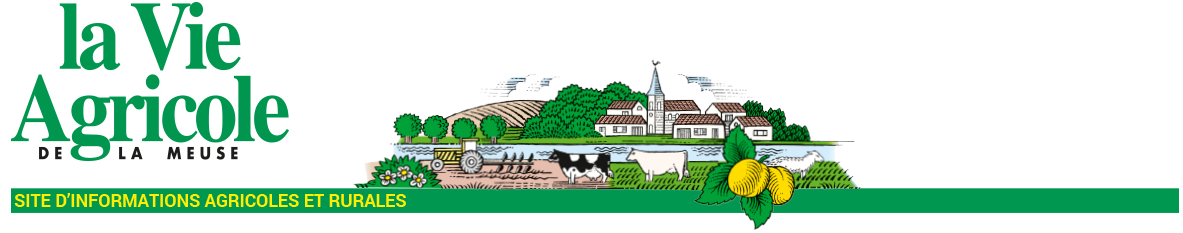Lors de l’assemblée générale des Jeunes Agriculteurs de la Meuse, le président, Adrien Seners a dressé un bilan de 2024, marqué par des crises multiples : instabilité politique, conditions climatiques difficiles, problèmes sanitaires et dégâts de gibiers. Malgré ces défis, le syndicat a continué à œuvrer pour le développement local.
«2024 a été l’année de tous les records» a martelé Adrien Seners, président des Jeunes Agriculteurs de la Meuse, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le mardi 4 février, à Nouillonpont. Devant un public composé de nombreux responsables politiques, adhérents et étudiants, le président, élu l’an dernier, a mis en lumière une année marquée par une succession de crises aux multiples facettes, mettant à rude épreuve les exploitations agricoles.
Des défis climatiques et sanitaires
Sur le plan politique, les agriculteurs ont dû faire face à une instabilité gouvernementale sans précédent, «comment pouvons-nous avancer dans un pays qui compte quatre gouvernements différents en un an» a-t-il déploré. Malgré cette absence d’interlocuteur au plus haut niveau de l’état, les agriculteurs se sont mobilisés sans relâche et ont manifesté à plusieurs reprises pour défendre leurs intérêts et faire avancer leurs dossiers.
Sur le plan climatique, les conditions ont été tout aussi éprouvantes. La pluie, omniprésente tout au long de l’année, a perturbé les semis, décalé les récoltes et dégradé la qualité des fourrages. Beaucoup de cultures ont souffert. «La moisson fut catastrophique avec peu de rendement, pas de qualité, des prix moyens, mais les charges en nette augmentation» a poursuivi Adrien Seners. Les agriculteurs ont dû composer avec des conditions de travail difficiles.
Côté sanitaire, l’élevage a également vécu une année noire. La Fièvre catarrhale ovine (FCO) a «frappé de plein fouet notre département», mettant en péril de nombreuses exploitations. Les éleveurs ont dû faire face à des défis supplémentaires pour maintenir la santé de leurs troupeaux. La situation a créé une tension sur les ressources humaines et financières. «Nous devons travailler et réfléchir à une vaccination la mieux adaptée à nos élevages afin d’aborder la campagne estivale 2025 plus sereinement» a-t-il insisté.
Enfin, le président a conclu son rapport moral par un record dont la Meuse aurait pu se passer, celui des dégâts dûs à la faune sauvage. «En 2024, ce sont plus de 3.000 hectares de terres agricoles qui ont été dévastés par des sangliers et autres gibiers, sans parler des dégâts en forêt. C’est une honte !» a fustigé Adrien Seners. La Meuse est ainsi devenue le premier département français en termes de dégâts de gibier sur les surfaces agricoles. Le président a salué le soutien du préfet, Xavier Delarue, qui a pris la mesure de cette problématique et qui soutient les agriculteurs face à cette pression.
Des animations pour le territoire
Malgré ces multiples crises, les jeunes ont continué à œuvrer pour le développement de leurs projets et à animer le territoire. Thomas Voisin, secrétaire général adjoint, a détaillé les différentes actions qui se sont déroulées en 2024. Parmi celles-ci, la journée des adhérents permet «de se rencontrer et de renforcer la cohésion du groupe» a-t-il expliqué. Les membres bénévoles ont également participé à la balade solidaire de Groupama, au passage de la flamme olympique. Ils ont aussi animé un stand à Verdun Expo, sans oublier le rallye découverte Meuh z’en balade sur les cantons de Saint-Mihiel et Pierrefitte ; et bien sûr, l’organisation du concours de labours dans le cadre de Meuh z’en fête, l’événement emblématique des JA, qui attire chaque année un large public et permet de valoriser le savoir-faire des agriculteurs du département.
Le renouvellement des générations est un autre sujet primordial pour le syndicat. Vincent Doudoux, responsable «installation», a présenté des chiffres détaillés sur les profils des nouveaux installés en 2024. Le PAI (Point accueil installation) a rencontré 112 porteurs de projet l’an dernier. Sur les 46 installations aidées en 2024, 32,6 % ont retenu un système bovins lait et céréales et 23,9 % se sont orientés sur un système polyculture-élevage viande.
Ce modèle de production reste majoritaire dans le département. D’ailleurs, une table ronde a permis d’approfondir la question de la résilience des systèmes polyculture-élevage face aux crises. Quatre experts et des témoins ont présenté des données économiques du secteur, pour dresser un bilan de l’année 2024 et discuter des perspectives pour les mois à venir (lire par ailleurs).
En 2025, le syndicat, qui réunit 235 adhérents, continuera de se mobiliser et défendre l’agriculture face aux nombreux défis qui se profilent à l’horizon.