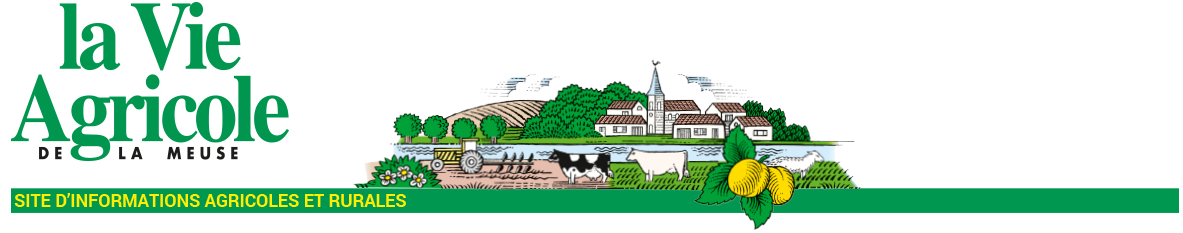Au Domaine de la Goulotte, à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, le vin se construit au fil des saisons, porté par le travail de la famille Antoine. Les vendanges, commencées le 15 septembre, sont le fruit d’une année de soins attentifs. Dès la fin de cette récolte, le travail se poursuit en cave, jusqu’à la sortie des premières bouteilles de chardonnay en mai prochain.
Au Domaine de la Goulotte, à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, les vendanges ont débuté le 15 septembre. Sur les pentes douces des côtes de Meuse, les grappes mûres témoignent du travail d’une année entière. Et la récolte s’annonce prometteuse. À la tête de l’exploitation, Lucie, Éloïse et Julien Antoine, les enfants de la famille, poursuivent le travail engagé par leurs parents, avec passion et méthode.
L’exploitation s’étend sur 7,5 ha en label HVE, avec 5,5 ha en production, les deux hectares restants étant réservés aux jeunes plants avec des changements de cépages. «Nous allons également changer le palissage et avoir plus d’espace entre les rangs, avec une sélection de vignes plus hautes» explique Lucie Antoine, qui renouvelle les vignes.
«Pas de tri à faire»
Comme chaque année, la récolte a débuté par les cépages blancs : chardonnay, auxerrois, puis pinot gris. Plus tard viendront les cépages destinés aux vins gris, élaborés à partir de gamay, et enfin les rouges, fruits d’un assemblage de gamay et de pinot noir. «Il n’y a pas de tri à faire, les raisins sont de qualité, même si les pluies de fin août ont légèrement dilué le sucre accumulé pendant les fortes chaleurs de l’été», se réjouit Lucie Antoine.
Avec un peu de recul, elle estime toutefois qu’une gestion plus rigoureuse de l’enherbement sous les rangs aurait pu permettre une meilleure quantité. Malgré cela, les premières bennes arrivent au pressoir avec de beaux raisins, et la viticultrice se dit globalement satisfaite de ce début de récolte.
Tout au long de l’année, le travail est réparti entre les trois associés, et pendant les vendanges, Lucie Antoine reste en permanence dans les vignes. C’est elle qui encadre l’équipe de vendangeurs, mobilisée pour une période d’une semaine à dix jours afin de récolter les raisins.
Une main-d’œuvre étudiante
«Habituellement, nous avons une vingtaine de vendangeurs. L’an dernier, nous avons rencontré des difficultés de recrutement et nous n’étions qu’une quinzaine», se souvient-elle. Cette année, le problème ne s’est pas posé et les effectifs sont complets, sans absentéisme.
En effet, les trois quarts des vendangeurs sont des étudiants en deuxième année de BTS ACSE à l’EPL Agro de Bar-le-Duc. «Cette expérience va nous aider à financer une grande partie de notre voyage de fin d’études», expliquent les jeuns. À leurs côtés, quelques habitués des saisons complètent l’équipe.
Le travail, qui commence dès 8h avec une pause en milieu de matinée, est bien organisé. Dans une bonne ambiance, seize cueilleurs se répartissent sur huit rangs, en face à face, afin de ne laisser aucune grappe derrière eux. «Il faut bien effeuiller, surtout avec les blancs» rappelle la viticultrice. Quatre porteurs assurent les allers-retours entre la vigne et les palettes, prêtes à être transportées au pressoir.
Même si chacun avance à son rythme, la cadence collective permet de vendanger environ un hectare par jour. Sur le domaine, la récolte se fait donc rapidement. Cette année, les vendangeurs ne seront pas rappelés en octobre pour des vendanges tardives, la météo ne s’y prête pas. «Il faut éviter trop de pluie en septembre» poursuit Lucie. Raté pour cette fois. Ce sera pour une autre année.
Pendant ce temps, au niveau de la cuverie, Éloïse et Julien s’affairent à la réception et au pressurage des premiers raisins, aidés par Cléa Thiery, leur apprentie. «La qualité du fruit est essentielle, c’est elle qui conditionne la réussite du vin», soulignent-ils. «Pour faire du bon vin, il faut une bonne récolte. Tout se passe à la vigne tout au long de l’année. Les conditions de l’année précédente jouent également sur la qualité du raisin».
Le duo réalise entre un et deux pressoirs par jour, selon les arrivées et les cépages, tout en réfléchissant aux assemblages à venir. En plus du Col de Velours, méthode traditionnelle qui symbolise le domaine, cette année les vignerons lancent Ouranos, «le seul assemblage en mousseux qui réunit pinot gris et chardonnay», sourit Julien Antoine.
Avec une gamme étendue, le domaine propose également des eaux-de-vie, des jus sans alcool, ainsi que des apéritifs comme la Lirette (rouge ou blanche), élaborée à base de jus de raisin et de marc des Côtes de Meuse. Cette dernière est produite à partir d’une vigne hybride issue d’un croisement planté après la crise du phylloxéra. «Nous avons conservé cette espèce, qui nécessite très peu de traitement, pour la Lirette et la cuvée familiale», précise-t-il.
Une mise en bouteille sur place
Les blancs sont pressés immédiatement avant d’être débourbés. Le jus récupéré est ensuite changé de cuve avant l’incorporation des levures. Pour les rouges, il faut attendre de pouvoir visualiser les stocks, «pour savoir quel assemblage nous allons pouvoir faire». Le pressurage des vins rouges se déroule quelques jours ou quelques semaines après la vendange selon le type de vin que le vigneron souhaite obtenir et «pour avoir une bonne homogénéisation». La fermentation a lieu dans les deux semaines qui terminent le pressurage. «Nous gardons les vins environ un an avant la mise en vente». Les vins vieillissent en cuve inox, et la mise en bouteille s’effectue sur place, au fur et à mesure de la diminution des stocks.
La commercialisation se fait principalement au caveau, où 90 % des bouteilles sont vendues en direct. Les associés travaillent également avec quelques restaurateurs et épiceries locales, privilégiant les circuits courts et le contact direct avec leurs clients. Le magasin est ouvert tous les jours, avec le soutien précieux de leur mère, qui, bien qu’à la retraite, reste très présente et impliquée dans la vie de l’exploitation viticole.
A noter que le Domaine de la Goulotte fait partie des cinq exploitations formant l’IGP Côtes de Meuse. Une reconnaissance qui, au-delà de la qualité des vins, valorise le travail des vignerons du département attachés à leur terroir et unis dans une dynamique d’entraide. «Ici, ce sont plus des collègues que des concurrents», sourit Lucie qui travaille avec eux sur plusieurs manifestations, dont une marche gourmande et un salon local.
Mais avant de savourer le prochain chardonnay, il faut laisser au temps le soin de faire son œuvre et attendre le mois de mai. Comme souvent dans le vin, la patience est le plus bel ingrédient.