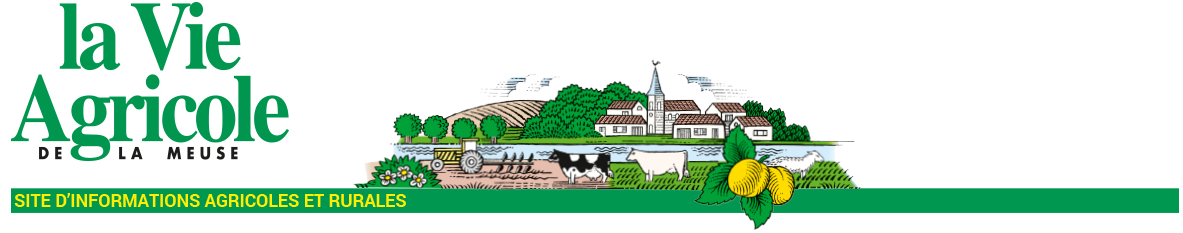La FDSEA dénonce une prédation en constante progression et des exploitations fortement fragilisées. Pour les représentants agricoles, le loup ne doit pas mettre en péril l’élevage à l’herbe, pilier du paysage et de l’économie rurale. Des témoignages mettent en lumière un double mal-être : celui des éleveurs et celui des animaux. Une situation que la profession juge désormais intenable.
Afin d’être au plus proche des réalités du terrain et des difficultés rencontrées par les agriculteurs, la FDSEA de la Meuse a choisi de délocaliser ses conseils d’administration et d’organiser des échanges directement dans les exploitations. Une première rencontre «Parole de ferme» s’est déroulée le lundi 17 novembre à Seigneulles, avec pour sujet central la prédation du loup, en axant la discussion sur le mal-être des éleveurs et des animaux.
Les éleveurs victimes d’attaques se sont succédé pour témoigner sur la parcelle de Jean-François De Muer, éleveur ovin, lui-même touché en début d’année. Il se souvient parfaitement de ce dimanche 19 janvier, une journée qui devait être paisible en famille et qui s’est transformée en véritable calvaire.
Choc émotionnel et charge administrative
Ce jour-là, sur une parcelle de 13 hectares située à quelques mètres du village, son troupeau comptait 43 brebis. Trois ont été retrouvées mortes. «Les 40 restantes étaient terrorisées», raconte Jean-François De Muer, encore marqué par l’épisode. Suite à cette attaque, certains animaux agonisent pendant plusieurs heures avant le passage de l’OFB et des vétérinaires. Six jeunes bêtes ont dû être euthanasiées et onze autres recousues. Le vétérinaire est resté de 14h à 19h sur l’exploitation pour tenter de sauver les animaux blessés. À cela s’ajoutent les avortements et les pertes indirectes chez les brebis gestantes.
Mais le choc ne s’arrête pas à la dimension émotionnelle. L’éleveur rappelle aussi l’ampleur de la charge administrative : «après, il faut gérer tout le dossier. La facture du vétérinaire s’élève à 2.000 euros. Il faut avancer les frais, puis attendre trois mois pour être remboursé». Une situation qu’il résume d’une phrase : «ce n’est pas vivable».
Toute la matinée, les témoignages ont été dans le même sens, rappelant la souffrance animale, les pertes directes et indirectes, et le moral en berne des éleveurs face à une situation qui s’aggrave…
121 victimes en Meuse
Depuis le début de l’année en Meuse, 45 brebis ont été tuées, 21 ont dû être euthanasiées et 55 autres ont été blessées. Dans le département, la présence du loup se concentre principalement dans le Barrois et près de la frontière ardennaise. Et il ne s’agit pas d’un seul animal, mais bien de plusieurs. «Trois loups sont actuellement avérés sur le territoire grâce aux analyses ADN», a précisé Nicolas Perotin, président de la Chambre d’agriculture.
«À chaque suspicion d’attaque, des tests sont réalisés et envoyés dans un laboratoire privé», complète Isabelle Hofbauer, référente loup à la FDSEA. Un comptage précis est essentiel pour pouvoir engager un dialogue constructif avec l’administration.
Les dispositifs de protection existants (clôtures, aide-bergers, chiens de protection…) restent coûteux, chronophages et peu efficaces. Face à ce constat, elle ajoute que, le syndicat est «force de propositions, notamment avec la mise en place d’une clôture de protection spécifique». Cependant, cette dernière n’est pas encore homologuée dans le cadre du plan national loup.
Et les «solutions» actuellement proposées ne sont pas toujours adaptées aux zones de plaine, ont rappelé les éleveurs. La pose de dispositifs électrifiés demande une installation lourde. Elle ne répond pas aux réalités du terrain et peut même nuire à d’autres espèces qui ne sont pas des prédateurs. Le décalage entre le terrain et les mesures administratives devient, selon eux, de plus en plus insupportable.
Des conséquences multiples
Tous partagent le même constat : «notre métier, ce n’est pas d’aller tuer du loup. Nous souhaitons simplement que les textes évoluent pour que les troupeaux soient en sécurité», ont-ils insisté, appelant à des règles plus réalistes et mieux adaptées à leurs conditions de travail.
«Si l’on laisse le loup s’installer, certains élevages finiront par arrêter», alerte Xavier Arnould. Pour lui, les conséquences seraient multiples : disparition d’exploitations, perte de souveraineté alimentaire et dégradation des paysages façonnés par l’élevage. «Le loup ne doit pas mettre en péril nos troupeaux», insiste-t-il, appelant à trouver des solutions concrètes et des outils adaptés.
Le président de la FDSEA rappelle qu’à ce jour, aucun cadre réglementaire efficace n’existe. «Ce n’est pas tenable. Il faut des outils de régulation rapides», martèle-t-il. Selon lui, la sauvegarde de l’élevage à l’herbe en plein air dépend désormais de la capacité des pouvoirs publics à assumer leurs responsabilités.
Enfin, certains redoutent que la progression du loup vers les zones habitées ne finisse par menacer la sécurité des habitants des campagnes.
Face à une prédation qui s’intensifie en Haute-Marne
Des représentants des JA 52 et de la FDSEA 52 avaient également fait le déplacement pour témoigner de la forte pression du loup en Haute-Marne. Leurs interventions sont venues compléter les constats des éleveurs meusiens.
En moins d’un an, 175 attaques ont été recensées et près de 700 animaux ont été reconnus victimes du loup. «Les chiffres ont explosé», ont souligné Thomas Millot et Pierre-Edouard Brutel, respectivement président et référent loup des JA 52, rappelant que les éleveurs sont à bout et que plus personne ne souhaite s’installer en élevage ovin dans ces conditions.
Ils ont également rappelé l’historique de la présence du prédateur dans leur département. Le loup est avéré en Haute-Marne depuis 2014, avec un premier mâle identifié comme venant d’Italie. À partir de 2018-2019, le département est devenu une véritable zone de passage, où le prédateur trouve refuge chaque hiver. Mais depuis novembre 2024, les attaques se sont fortement intensifiées, notamment en zones de plaine, un milieu que le loup semble particulièrement apprécier. En mai, une première meute a été repérée : un mâle, une femelle et sept louveteaux, identifiés à la suite de multiples prédations.
Face à cette pression, les éleveurs s’interrogent : comment protéger leurs troupeaux ? Les outils actuellement proposés ne sont pas adaptés aux territoires de plaine. Et dans l’attente d’une évolution réglementaire, certains n’ont d’autre choix que de dormir tout l’été dans une caravane au milieu de leur troupeau, au détriment de leur vie familiale.«Il faut faire bouger les lignes et les textes», insiste Sandrine Brauen, secrétaire générale de la FDSEA 52. Les représentants haut-marnais soulignent que l’OFB intervient presque quotidiennement tant les attaques sont nombreuses, et appellent à travailler en concertation avec l’institution. «Nous avons l’impression que l’administration française découvre le loup» déplorent-ils.
«Pourtant, le loup est présent dans 80 % des départements français», rappelle Nicolas Perotin, président de la Chambre d’agriculture de la Meuse.